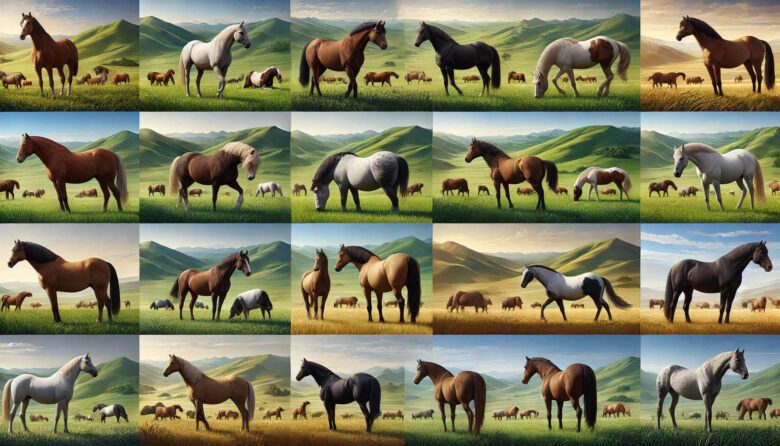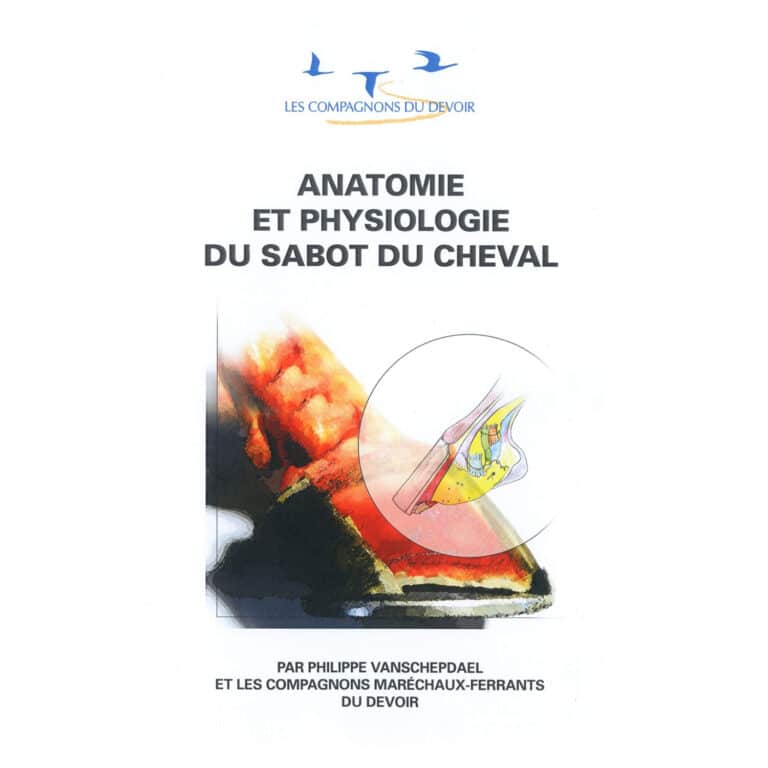Le syndrome naviculaire, chez les équidés, est une maladie dégénérative des membres antérieurs souvent identifiée chez les chevaux adultes. Causant une boiterie chronique et intermittente, elle résulte de facteurs multiples, tels qu’un parage inadapté, un ferrage inappropriée, un travail ou des sols inadéquats ou même lié à un facteur génétique ou surcharge ostéoarticulaire.
Un diagnostic précoce et une gestion adaptée, incluant des soins réguliers des pieds et des ajustements environnementaux, sont de mise pour préserver le bien-être de l’animal.
Symptômes du syndrome naviculaire
La maladie naviculaire affecte principalement les os naviculaires situés dans les pieds du cheval. Cette condition peut être extrêmement douloureuse et limiter la capacité d’un cheval à se déplacer normalement.
Les premiers symptômes sont parfois subtils et n’alertent pas immédiatement le propriétaire. Typiquement, le cheval peut présenter une légère boiterie ou une démarche irrégulière, en particulier après un repos prolongé ou lors de mouvements sur des surfaces dures.
D’autres signes incluent une sensibilité accrue autour du talon ou une réticence à participer aux activités habituelles, par exemple le saut ou le galop.
Détection précoce des symptômes
La détection précoce des symptômes est fondamentale pour gérer efficacement le syndrome naviculaire et réduire les impacts à long terme sur la santé du cheval. Les premiers signes à surveiller incluent :
- La réduction des foulées : Le cheval peut prendre des pas plus courts que d’habitude, chaque mouvement semblant être source de douleur,
- La baisse de performance : Une diminution notable de la performance, particulièrement lors des compétitions ou des entraînements, peut indiquer un inconfort lié au syndrome naviculaire,
- La position antalgique au repos : Le cheval peut adopter une position particulière pour soulager la douleur (se mettre au repos), afin de réduire la pression sur le ou les pieds affectés.
Progression des symptômes
Sans intervention, les symptômes du syndrome naviculaire chez les chevaux s’aggravent avec le temps. Ce qui commence comme une légère irrégularité dans la démarche peut évoluer en une boiterie prononcée.
Aussi, la boiterie est souvent plus marquée après des périodes de repos et s’améliore temporairement après un échauffement sur un sol tendre.
Diagnostiquer et intervenir rapidement, dans tous les cas, est primordial. Pour cela, une collaboration entre un vétérinaire et maréchal permet de diagnostiquer et de gérer efficacement le syndrome naviculaire, garantissant ainsi le bien-être du cheval et permettant de le garder en activité sportive (ou non) plus longtemps.
Causes de la maladie naviculaire
Le syndrome naviculaire, également connu sous le nom de maladie naviculaire, est une affection douloureuse du pied chez les chevaux, qui touche principalement l’appareil podotrochléaire. Cet appareil comprend l’os naviculaire (ou sésamoïde distal), le tendon fléchisseur profond, la bourse naviculaire, et les ligaments associés. Le développement de cette pathologie peut être influencé par plusieurs facteurs, parmi lesquels un parage inadéquat, une ferrage inappropriée, et des efforts intenses qui surchargent l’appareil podotrochléaire.
1. Parage inadéquat
Le parage est le processus d’entretien des pieds d’un cheval pour assurer une forme et un équilibre corrects. Un parage inadéquat peut causer ou aggraver le syndrome naviculaire de plusieurs manières :
- Déséquilibre des sabots : Si le sabot n’est pas paré de manière uniforme, cela peut entraîner une distribution inégale du poids et des forces exercées sur le pied. Cela peut augmenter le stress sur l’os naviculaire et les tissus associés, favorisant ainsi l’apparition de lésions.
- Longueur des talons : Des talons trop longs ou trop courts peuvent modifier la biomécanique du pied, augmentant la pression sur l’appareil podotrochléaire et les tendons environnants.
2. Ferrage inappropriée
La ferrage est l’application de fers sur les sabots des chevaux pour les protéger et corriger et améliorer les aplombs. Une ferrage inappropriée peut contribuer au développement de pathologies liées à l’appareil podotrochléaire de différentes manières :
- Fers mal ajustés : Des fers mal ajustés peuvent créer des points de pression anormaux sur le pied, ce qui peut entraîner une surcharge de l’os naviculaire et des structures environnantes.
- Fers inadéquats pour le terrain : Utiliser des fers inadaptés au type de terrain sur lequel le cheval travaille peut augmenter le risque de blessures. Par exemple, des fers inadaptés sur un sol dur peuvent augmenter les chocs et les vibrations, tandis que des fers inadaptés sur un sol mou peuvent ne pas fournir un soutien suffisant.
- Usage de fers orthopédiques inappropriés : Les fers orthopédiques sont parfois utilisés pour traiter ou prévenir des problèmes spécifiques. Cependant, s’ils sont mal appliqués ou inappropriés pour la condition spécifique du cheval, ils peuvent aggraver le problème au lieu de l’améliorer.
3. Efforts intenses
Les chevaux soumis à des efforts intenses, qu’il s’agisse de travail ou de compétition, sont plus susceptibles de développer des problèmes au niveau de l’appareil podotrochléaire. Voici comment cela peut se produire :
- Surmenage : Une activité excessive sans période de récupération adéquate peut entraîner une fatigue des structures du pied, rendant l’os naviculaire et les tissus environnants plus vulnérables aux microtraumatismes et aux lésions.
- Changements brusques d’activité : Passer soudainement d’un niveau d’activité modéré à intense peut surcharger l’appareil podotrochléaire, augmentant le risque de syndrome naviculaire.
- Terrain inadapté : Travailler sur des surfaces dures ou irrégulières sans protection adéquate peut intensifier les impacts sur le pied, augmentant le stress sur l’os naviculaire et les tissus associés.
4. La génétique
Certains chevaux sont prédisposés au syndrome naviculaire en raison de leur conformation anatomique et de leur hérédité. Les races ayant des pieds trop petits par rapport à leur taille, une mauvaise conformation des aplombs, ou une boîte cornée trop étroite sont plus à risque. Les races comme le Quarter Horse, le Pur-Sang et certaines lignées de chevaux de sport sont plus sujettes à ce problème.
5. Les sols inappropriés
Travailler sur des sols trop durs, caillouteux ou irréguliers peut provoquer des microtraumatismes répétés sur l’os naviculaire et ses structures associées (tendon fléchisseur profond, bourse podotrochléaire). À l’inverse, des sols trop mous peuvent favoriser une mauvaise absorption des chocs et des contraintes excessives sur l’appareil podotrochléaire.
6. Surcharge osthéoarticulaire
Une surcharge due à un travail intensif, un poids excessif du cheval, ou un ferrage inadapté peut entraîner une usure prématurée de l’os naviculaire et des tissus environnants. Les disciplines comme le CSO, le reining ou le dressage imposent des efforts répétés sur les antérieurs, ce qui favorise les microtraumatismes et l’inflammation chronique dans la région du pied.
Traitement du syndrome naviculaire
Chaque cas est différent et nécessite une prise en charge unique. Une fois le diagnostic du syndrome naviculaire posé, il existe plusieurs traitements adaptés en fonction de la cause : traitement médical, fers orthopédiques (ferrages kinésithérapiques), etc.
Diagnotic
Le diagnostic, souvent posé tardivement, repose sur plusieurs éléments. D’abord, il comprend des tests de flexions, au pas, et au trot sur divers types de sols. Il s’appuie ensuite sur de l’imagerie médicale, des échographies et des radiographies, pour visualiser les lésions et confirmer la le diagnotic.
Maréchalerie et ferrage correctrice
Le traitement inclut un parage et une ferrage correctrice adaptés pour rééquilibrer et soutenir le pied, essentiels pour réduire la pression sur l’appareil podotrochléaire.
Autres mesures de traitement
Pour soulager le cheval, il existe également quelques mesures complémentaires conseillées par le vétérinaire. Elles comprennent:
- Adaptation des sols
- Des échauffements et détentes adaptées,
- la limitation du travail en cercle,
- l’administration d’anti-inflammatoires en cas de douleur aiguë,
Une ferrage kinésithérapique conseillée
Pour soutenir le traitement et la gestion du syndrome naviculaire chez le cheval, divers produits de soins spécifiques sont également recommandés. On retrouve ici principalement des fers en aluminium kinésithérapique, adaptés selon le degré de sévérité de la maladie.
Prévention du syndrome naviculaire
La prévention du syndrome naviculaire repose sur des pratiques attentives et régulières de soin des pieds ainsi que sur une gestion appropriée de l’entraînement du cheval.
Bonnes pratiques de parage et ferrage
Un parage régulier et professionnel est incontournable pour maintenir l’équilibre du pied du cheval et prévenir les surcharges ostéoarticulaire. En combinant un parage correct avec une ferrage appropriée, on assure le bien-être et la performance optimale du cheval.


Travail et entraînement
Comme dit précédemment, préserver un programme d’exercices réguliers et modérés est très utile pour renforcer les structures du pied et améliorer la circulation sanguine chez le cheval. Un échauffement minutieux avant toute session de travail intensif est de rigueur pour préparer les pieds à l’effort et réduire le risque de blessures.
En adoptant ces stratégies préventives et en utilisant une ferrage kinésithérapique adaptée, il est possible de diminuer significativement le risque de développement du syndrome naviculaire et de prolonger la carrière sportive du cheval.
Vous avez des questions sur le syndrome naviculaire ?
Y'a t-il une différence entre la maladie du naviculaire et le syndrome podotrochléaire ?
Oui, il y a une différence entre la maladie du naviculaire et le syndrome podotrochléaire chez le cheval, bien que les deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable par erreur. Voici une clarification :
Maladie du naviculaire
Définition stricte : Terme historiquement utilisé pour désigner des lésions spécifiques de l’os naviculaire.
Caractéristiques :
- Se concentre sur les lésions dégénératives de l’os naviculaire lui-même.
- Ces lésions peuvent inclure des modifications osseuses visibles sur des radiographies, comme des kystes ou des irrégularités.
- On parle d’une condition chronique affectant directement la structure de l’os naviculaire.
Diagnostic : Confirmé par imagerie, comme des radiographies ou une IRM, montrant des altérations précises de l’os.
Syndrome podotrochléaire
Définition : Terme plus large et plus moderne qui englobe toutes les affections des structures entourant l’appareil podotrochléaire, dont l’os naviculaire fait partie.
Structures concernées :
- Os naviculaire.
- Ligaments associés (suspenseurs et collatéraux).
- Tendon fléchisseur profond (à son passage sous l’os naviculaire).
- Bourse podotrochléaire (qui se situe sous l’os naviculaire).
Caractéristiques :
- Ce terme décrit une douleur ou une pathologie dans la région du naviculaire sans nécessairement impliquer de lésion visible de l’os.
- Il peut inclure des inflammations, des lésions ligamentaires ou tendineuses, et des problèmes fonctionnels.
- Le syndrome podotrochléaire peut se produire sans anomalies radiographiques de l’os naviculaire.
Diagnostic : Plus souvent basé sur un examen clinique, des anesthésies ciblées et des techniques d’imagerie avancées comme l’IRM ou l’échographie, qui permettent d’évaluer les tissus.
Principales différences
| Aspect | Maladie du naviculaire | Syndrome podotrochléaire |
| Portée | Affection spécifique de l’os naviculaire | Ensemble des structures autour du naviculaire |
| Focus anatomique | Os naviculaire | Os, tendons, ligaments, bourse |
| Signes radiographiques | Modifications visibles sur radiographies | Pas toujours visibles sur radiographies |
| Imagerie nécessaire | Radiographies | IRM ou échographie souvent requises |
- La maladie du naviculaire est une forme spécifique de syndrome podotrochléaire, mais toutes les affections du syndrome podotrochléaire ne sont pas liées à une lésion de l’os naviculaire.
- Aujourd’hui, les vétérinaires privilégient le terme syndrome podotrochléaire, car il reflète mieux la complexité des structures impliquées et permet une prise en charge plus globale.
Qu'est-ce que le syndrome naviculaire chez le cheval ?
Le syndrome naviculaire est une pathologie chronique principalement observée dans les membres antérieurs des chevaux, généralement à partir de l’âge de quatre ans. Cette condition est souvent dégénérative, caractérisée par une inflammation et une dégradation de l’os naviculaire et des structures associées, ce qui entraîne une boiterie.
Quels sont les premiers symptômes du syndrome naviculaire ?
Les premiers symptômes du syndrome naviculaire se manifestent par une réduction de la longueur des foulées, une baisse notable de performance lors d’activités équestres et une posture antalgique au repos, où le cheval essaie de minimiser la pression sur les pieds douloureux.
Comment diagnostique-t-on la maladie naviculaire ?
Le diagnostic du syndrome naviculaire commence par une évaluation clinique détaillée, incluant des tests de démarche à l’arrêt, au pas et au trot, sur des sols durs et souples pour observer les variations de la boiterie. L’imagerie médicale, telle que la radiographie, l’échographie ou l’IRM, est ensuite utilisée pour examiner l’état interne du pied et confirmer la présence de la maladie.
Quels traitements sont disponibles pour le syndrome naviculaire ?
Le traitement du syndrome naviculaire inclut principalement la maréchalerie spécialisée avec des fers correcteurs dits kinésithérapiques, adaptés aux différents stades de la maladie (Grade). D’autres mesures comprennent l’aménagement des sols en fonction de la pathologie, des échauffements soigneusement planifiés et progressifs (voir avec le vétérinaire), la limitation des exercices qui imposent une rotation excessive des membres (voir avec également avec le véto), et l’administration d’anti-inflammatoires pour gérer la douleur et l’inflammation lors des poussées aiguës.
Comment prévenir le syndrome naviculaire ?
La prévention du syndrome naviculaire repose sur des soins réguliers et méticuleux des pieds du cheval. Un parage et une ferrage kinésithérapique adaptée et adaptés sont les premières clés, de même qu’un programme d’entraînement équilibré qui implique des échauffements appropriés avant l’exercice. Ces pratiques peuvent aider à réduire le risque de développement de cette affection douloureuse.